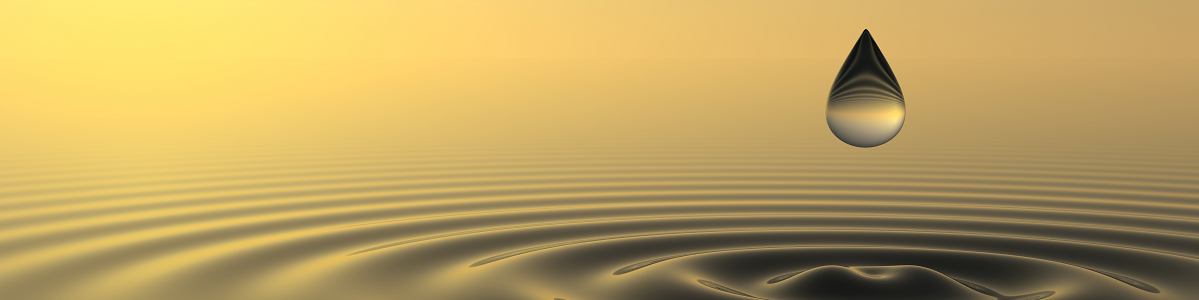Relation entre thyroïde et stress : Comprendre pour mieux agir

Il y a des consultations qui se ressemblent au premier regard et qui, pourtant, demandent une lecture en relief. La personne arrive souvent avec les mêmes mots : « Je suis épuisé(e), mais je n’arrive pas à dormir », « Je me réveille déjà fatigué(e) », « Je suis sous lévothyroxine, mes bilans sont “bons”, et pourtant je ne vais pas bien ». On entend parfois aussi l’autre versant : « Dès que je prends une petite dose d’hormone thyroïdienne, je deviens anxieux(se), j’ai des palpitations, je dors mal ». On cherche alors “la cause unique” : la thyroïde, les surrénales, le cortisol, un complément “miracle”, ou un test “révélateur”. En pratique clinique, c’est rarement une pièce isolée qui explique tout ; c’est le dialogue entre plusieurs systèmes de régulation, et surtout le coût biologique d’un organisme qui s’adapte en continu à des signaux de stress — externes (rythme de vie, travail, lumière artificielle, écrans, conflit, charge mentale) et internes (inflammation, hypoglycémies réactionnelles, déficit en micronutriments, troubles digestifs, douleurs, infections, toxiques, manque de sommeil).
La clé de compréhension la plus féconde, en médecine nutritionnelle et fonctionnelle, est de considérer le corps comme un ensemble de boucles de régulation dont l’objectif premier n’est pas “le confort”, mais la survie. Dans cette logique, la thyroïde et l’axe du stress ne sont pas deux sujets séparés : ils constituent un couple physiologique, une sorte de duo “carburant–frein–réglage fin” qui ajuste en permanence la disponibilité énergétique, l’inflammation, le sommeil, la glycémie, la température, l’humeur et la motivation. Comprendre ce duo, c’est déjà commencer à traiter — parce qu’on cesse d’interpréter des symptômes comme des “défaillances” et on les revoit comme des adaptations coûteuses.
Axe du stress et thyroïde, un lien intime
L’axe du stress (souvent appelé axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien) fonctionne comme une tour de contrôle. Quand le cerveau perçoit une menace (réelle ou interprétée), l’hypothalamus orchestre une réponse qui aboutit à la production de cortisol. Le cortisol n’est pas “l’hormone du mal” : c’est un outil vital. Il rend disponible du glucose, mobilise des acides gras, module l’immunité, augmente la vigilance, influence la pression artérielle, et synchronise des rythmes biologiques. Mais — nuance essentielle — ce cortisol n’agit pas en niveau “fixe”. Il est rythmé. Chez la plupart des individus, on attend un pic dans la première partie de la matinée, puis une décroissance progressive vers le soir, afin de permettre l’endormissement et la réparation nocturne. Quand cette pente diurne s’aplatit (cortisol du matin trop bas, cortisol du soir trop haut, ou courbe “plate”), on n’a pas nécessairement une maladie surrénalienne, mais on observe un marqueur fréquent de désadaptation au stress chronique et de dérèglement circadien. Et cette pente n’est pas qu’un détail académique : une méta-analyse de grande ampleur a montré qu’un profil de cortisol plus “plat” est globalement associé à de moins bons marqueurs de santé mentale et physique, avec un signal particulièrement marqué pour les paramètres immunitaires et inflammatoires (9).
En miroir, l’axe thyroïdien (hypothalamo-hypophyso-thyroïdien) est l’autre grand chef d’orchestre du métabolisme. L’hypothalamus stimule l’hypophyse (TSH), qui stimule la thyroïde (T4 et T3). La T3, hormone active, agit comme un régulateur du “débit” cellulaire : elle influence la production d’ATP, la thermogenèse, la motilité digestive, la vitesse de renouvellement tissulaire, la fréquence cardiaque, la sensibilité aux catécholamines. Là aussi, le système est rythmé : la TSH a une variation nycthémérale, et le sommeil participe à l’organisation de ces rythmes. Quand le sommeil se fragmente ou se raccourcit, la biologie paie une facture mesurable : on observe des altérations métaboliques (insulinosensibilité, appétit) et des modifications endocrines, incluant le cortisol, mais aussi des indices thyroïdiens, dans des protocoles expérimentaux de restriction de sommeil (11). Autrement dit, chez un(e) patient(e) “fatigué(e)”, le sommeil n’est pas un simple symptôme : c’est un levier causal, et parfois le premier domino.
Le lien intime entre ces deux axes se voit dès qu’on observe ce que fait le cortisol à la thyroïde… et ce que fait la thyroïde au cortisol. D’un côté, les glucocorticoïdes (endogènes ou exogènes) peuvent diminuer la sécrétion de TSH ; c’est documenté expérimentalement, et cela fait partie des raisons pour lesquelles un contexte de corticothérapie, de stress biologique majeur ou d’hypercortisolisme peut perturber l’interprétation d’un bilan thyroïdien (5). De l’autre côté, l’état thyroïdien modifie la cinétique du cortisol. Dans une étude classique, chez des hommes en hypothyroïdie franche, la production endogène de cortisol était globalement normale, mais les concentrations moyennes sur 24 h étaient élevées en raison d’une clairance métabolique diminuée : le cortisol “reste” plus longtemps (6). Voilà une nuance clinique majeure : une personne hypothyroïdienne peut donner l’impression d’avoir “trop de cortisol” si l’on regarde une photo biologique isolée, alors que le problème est parfois un ralentissement de sa dégradation. Et inversement, quand on introduit ou augmente une substitution par lévothyroxine, on accélère la clairance du cortisol : chez certains patients, cette bascule peut se traduire par une sensation de chute brutale de “ressources” (fatigue, malaise, intolérance au stress, réveils nocturnes), surtout si l’axe du stress était déjà fragilisé ou si une insuffisance surrénalienne vraie était méconnue. C’est précisément pour cela que, dans les situations à risque, la prudence endocrinologique est une règle de sécurité : traiter la thyroïde sans repérer une insuffisance surrénalienne authentique peut être dangereux.
La fatigue des surrénales, un concept pseudoscientifique qui cache une autre réalité

Ici, il faut être très clair, parce qu’Internet mélange tout. L’“insuffisance surrénalienne” est une entité médicale, avec des critères diagnostiques et des tests validés. Les recommandations de l’Endocrine Society rappellent que le test de stimulation à l’ACTH (corticotropine) est l’outil de référence (“gold standard”) pour confirmer une insuffisance surrénalienne primaire ; à défaut, un dépistage initial peut s’appuyer sur le cortisol plasmatique matinal et l’ACTH, complété par l’évaluation étiologique (notamment anticorps anti-21-hydroxylase) (4). La littérature rapporte des situations où l’introduction de lévothyroxine avant la correction glucocorticoïde dans une insuffisance surrénalienne associée a pu précipiter une décompensation, ce qui illustre la logique physiologique de la clairance accrue du cortisol sous hormone thyroïdienne (15).
À côté de cette réalité médicale, il existe un autre récit, immensément populaire, mais scientifiquement fragile : celui de la fatigue des surrénales. Une revue systématique a conclu, en 2016, qu’il n’existait pas de preuves robustes permettant de valider la fatigue des surrénales comme diagnostic médical (7). L’Endocrine Society, dans sa communication au public, insiste sur l’absence de preuve scientifique, sur le caractère non spécifique des symptômes, sur l’absence de test validé, et sur le risque de manquer la vraie cause (8). Tout cela est juste… et pourtant, il reste un paradoxe clinique que beaucoup de praticiens observent : de nombreux patients vont mieux quand on applique une stratégie structurée centrée sur le sommeil, les rythmes, la stabilité glycémique, l’inflammation, la densité micronutritionnelle et les comportements de récupération. La solution n’est pas de nier l’expérience vécue ; c’est de corriger le cadre conceptuel. Autrement dit : ce n’est pas “la surrénale fatiguée”, c’est souvent une physiologie qui se met en mode économie, une synchronisation circadienne abîmée, et une énergie cellulaire qui ne suit plus le rythme imposé. Le cortisol n’est plus “au bon moment”, et la thyroïde devient l’amplificateur de ce déséquilibre.
On comprend alors pourquoi certains patients “ne tolèrent pas” l’hormone thyroïdienne. Parfois, c’est simplement un surdosage relatif (même discret) ou une sensibilité accrue (perte de poids, changement d’absorption, interactions) — raison pour laquelle les recommandations de prise et le suivi biologique restent fondamentaux (1). Mais parfois, la réaction anxieuse et l’insomnie viennent d’un système nerveux déjà sursollicité, dont les freins nocturnes sont défaillants. Si la substitution thyroïdienne augmente le débit métabolique, le corps peut “ressentir” cette accélération comme une agression alors que le sommeil est fragmenté, la glycémie instable et les réserves micronutritionnelles basses. La médecine fonctionnelle décrit cela comme une inadéquation entre “demande” et “capacité”. La demande augmente (métabolisme), la capacité reste limitée (récupération, substrats, régulation), et le patient vit une hypervigilance.
Les bilans de sang à évaluer avec intelligence

Dans cette lecture, le bilan biologique n’est pas un simple rituel : c’est une cartographie. La cartographie minimale, chez un patient qui présente une fatigue persistante, une intolérance au stress, des troubles du sommeil et un contexte thyroïdien, comprend au moins : TSH + FT4 (et FT3 selon contexte), anticorps anti-TPO (± anti-thyroglobuline), NFS, ferritine, B12, folates, CRP (ou autre marqueur inflammatoire), ionogramme (Na/K), fonction hépatique, créatinine, glycémie à jeun et HbA1c. Chez les patients avec symptômes digestifs, amaigrissement, diarrhées, carences, ou auto-immunité multiple, la recherche de maladie cœliaque (tTG IgA + IgA totales) est souvent pertinente. Chez ceux qui décrivent hypotension, malaises, hyperpigmentation, perte de poids, hyponatrémie, ou fatigue “hors norme”, un cortisol plasmatique matinal avec ACTH (et, si doute, test de stimulation) s’impose plutôt que des panels non validés (4).
Il faut aussi parler d’un piège fréquent : la “normalité” d’un bilan thyroïdien peut masquer une variabilité clinique. Les recommandations internationales rappellent que le traitement substitutif repose principalement sur la lévothyroxine, avec une individualisation, et que les symptômes ne se résument pas toujours à un chiffre isolé (1). En pratique, si un patient a une bonne TSH mais va mal, la question utile n’est pas d’emblée d’augmenter la dose, mais plutôt évaluer si l’absorption est correcte, timing régulier. Existe-t-il des interactions alimentaires ou médicamenteuses ? des carences (fer, B12) qui miment l’hypothyroïdie ? des apnées du sommeil ? une dépression ? une inflammation ? La levothyroxine est particulièrement sensible aux conditions de prise ; les recommandations insistent sur une prise à jeun ou au coucher avec un intervalle suffisant, et sur l’espacement avec la prise de calcium, de fer, de soja ou de certains aliments et boissons (2,3). Dans la vraie vie, un café pris “juste après” le comprimé, ou un complément de fer/calcium pris trop proche, peut suffire à dérégler le TSH et à donner l’impression d’un “problème d’ajustement hormonal”, alors qu’on est face à un problème d’absorption et de variabilité (3).
Rythmes, sommeil stabilité glycémique et inflammation de bas grade, les vrais leviers du changement
À ce stade, on voit se dessiner une approche très concrète : avant de chercher le rare, il faut réparer le probable. Et le probable, chez la plupart des patients modernes, c’est la désynchronisation : lumière artificielle tardive, réveils irréguliers, dette de sommeil, repas tardifs, grignotage, excès de stimulants, stress cognitif constant, sédentarité, inflammation de bas grade. La physiologie n’aime pas l’irrégularité. Les horloges internes — cérébrales et périphériques (foie, tissu adipeux, muscle, intestin) — se calent sur des signaux répétitifs. La lumière du matin, l’heure du lever, la première prise alimentaire, l’activité physique, la baisse de lumière le soir : ce sont des donneurs de temps. Quand ils deviennent chaotiques, le cortisol et la thyroïde deviennent chaotiques aussi, non pas parce que l’organe “casse”, mais parce que le système perd son tempo.
Les données sur le sommeil le montrent avec une clarté presque brutale. Dans des études de restriction de sommeil, on observe des altérations endocriniennes et métaboliques, avec notamment des modifications du cortisol et des signaux thyroïdiens (11). Cela donne une règle clinique simple : tant que la dette de sommeil persiste, toute stratégie “hormonale” est moins efficace, parfois même contre-productive. D’où l’intérêt de traiter le sommeil comme un traitement à part entière, pas comme une hygiène de vie optionnelle. Les recommandations européennes récentes sur l’insomnie réaffirment que la thérapie cognitivo-comportementale de l’insomnie est le traitement de première ligne, y compris via des formats numériques, tandis que les hypnotiques ne doivent être envisagés que sur de courtes durées et dans des conditions précises (12). Cette hiérarchie est précieuse en pratique : elle invite à traiter la cause (conditionnement d’hyperéveil, rythmes, anxiété anticipatoire) plutôt qu’à anesthésier le symptôme.
La lumière est l’autre médicament silencieux. Une étude devenue emblématique a montré qu’une exposition à un cycle naturel de lumière (type camping sans lumière artificielle) pouvait avancer rapidement l’horloge biologique de personnes se disant “couche-tard”, avec des endormissements plus précoces et des réveils plus matinaux en quelques jours. Ce résultat n’est pas une morale (“vous devriez vous coucher tôt”), c’est une information thérapeutique : l’horloge n’est pas une identité, c’est une plasticité. Dans la clinique thyroïde–stress, cette plasticité est une chance. Elle signifie qu’un patient peut reconstruire un pic de cortisol matinal et retrouver un sommeil nocturne plus dense en changeant ses signaux circadiens — parfois plus vite qu’il ne l’imagine.
Dans la même logique, le travail de nuit et les rythmes décalés ne sont pas un simple désagrément : ils constituent une contrainte biologique mesurable. Des travaux récents associent le travail posté à un risque plus élevé de dysfonction thyroïdienne, incluant des signaux de risque accru d’hypothyroïdie ou d’hypothyroïdie infraclinique dans certaines populations (15,16). Cela ne signifie pas que “le travail de nuit donne Hashimoto”, mais cela rappelle qu’un stress circadien chronique peut modifier les axes hormonaux, la glycémie, l’inflammation et la récupération, et qu’un patient “en horaires” doit être traité avec un protocole adapté plutôt qu’avec des conseils standards impossibles à tenir.
Le deuxième grand levier, après les rythmes, est la stabilité glycémique. C’est un point où la médecine nutritionnelle est décisive, parce que la glycémie est un stress interne. Une hypoglycémie (même modérée) déclenche une réponse contre-régulatrice : adrénaline, cortisol, fringales, agitation, réveils nocturnes. Beaucoup de patients “anxieux le soir” ne le sont pas uniquement par psychologie : ils le sont aussi par physiologie, parce que leur dîner est trop léger en protéines/fibres, trop riche en sucres rapides, ou trop tardif, et que la nuit devient un champ de micro-alertes métaboliques. Dans les stratégies modernes, la chrononutrition (quand on mange) complète la nutrition (ce qu’on mange). Des protocoles d’alimentation restreinte dans le temps, notamment quand l’apport est plus tôt dans la journée (“early time-restricted feeding”), ont montré des effets métaboliques favorables (sensibilité à l’insuline, tension artérielle, appétit oxydatif) dans des essais contrôlés (17). Là encore, le message n’est pas d’imposer un dogme, mais de disposer d’un outil : chez certains patients, avancer l’heure du dernier repas et stabiliser les apports peut améliorer simultanément la glycémie nocturne, le sommeil, et la tolérance au stress.
Le troisième levier est l’inflammation de bas grade, particulièrement centrale dans Hashimoto. Sur le plan fonctionnel, l’inflammation est un signal de danger interne. Elle pousse l’organisme vers le mode économie, perturbe le sommeil, altère l’humeur, rigidifie les rythmes, et peut influencer la conversion périphérique des hormones thyroïdiennes. Les modèles alimentaires de type méditerranéen, riches en polyphénols, fibres, oméga-3 alimentaires, légumineuses, fruits/légumes, huile d’olive, et pauvres en ultra-transformés, sont associés à une baisse de biomarqueurs inflammatoires dans des synthèses de la littérature (18). En consultation, cela se traduit par un principe simple : l’objectif n’est pas une “diète parfaite”, mais une réduction nette des pics inflammatoires répétés (alcool, sucres liquides, ultra-transformés, excès d’oméga-6 industriels, déficit en fibres), et une augmentation de la densité micronutritionnelle.
Mieux utiliser les compléments
Dans ce socle, les compléments alimentaires deviennent des adjuvants — pas des remplaçants. Le risque, aujourd’hui, n’est pas l’absence de compléments : c’est la poly-supplémentation confuse, parfois dangereuse, et souvent inutile. Exemple critique : les produits vendus comme “adrenal support”. Une étude a analysé des compléments “soutien surrénalien” en vente libre et a retrouvé, dans tous les produits testés, une quantité détectable de T3, et dans beaucoup, des stéroïdes (pregnénolone, budésonide, etc.), ce qui expose à des effets endocriniens cachés et à des risques réels (10). C’est une alerte à intégrer au protocole : on ne “soutient” pas un patient Hashimoto anxieux et insomniaque avec un produit susceptible de contenir de la T3 ou un corticoïde non déclaré. C’est l’inverse d’une médecine précise.
Alors, quels compléments ont une utilité raisonnable, quand ils sont choisis avec indications, doses et durée, et intégrés à une stratégie globale ? Le magnésium est souvent pertinent, non parce qu’il “guérit l’axe du stress”, mais parce qu’il intervient dans la neurotransmission, la relaxation neuromusculaire, et que des déficits relatifs sont fréquents (alimentation pauvre en végétaux/minéraux, stress, sport, troubles digestifs). Des essais et des revues suggèrent un bénéfice modeste mais réel sur certains paramètres de sommeil chez des populations ciblées (21). En pratique, on privilégie des formes bien tolérées (bisglycinate, citrate selon transit), on ajuste la dose au confort digestif, et on évite chez l’insuffisant rénal non suivi. La glycine est un autre outil intéressant, souvent sous-estimé. À doses de l’ordre de 3 g le soir, des études ont montré une amélioration subjective de la qualité du sommeil, avec des mécanismes plausibles (thermorégulation, neurotransmission) (22,23). C’est simple, peu coûteux, et compatible avec un protocole “peu de compléments, mais bien choisis”. La L-théanine (acide aminé du thé vert) peut aider certains profils “mental qui mouline”, avec un effet de réduction de l’hyperéveil chez des sujets anxieux ou stressés ; des synthèses récentes suggèrent un intérêt sur le stress/sommeil, même si la qualité des données varie selon les essais (24). Elle ne remplace pas la TCC-I, mais elle peut faciliter l’entrée dans le sommeil chez des patients qui décrivent surtout une agitation cognitive. Les oméga-3, lorsqu’ils sont indiqués (apports alimentaires faibles, inflammation, symptômes anxieux), disposent d’un corpus de données en faveur d’un effet anxiolytique modéré dans certaines conditions, même si les résultats et les doses optimales restent débattus et hétérogènes (25–27). Dans une perspective médicale, on choisit un produit tracé, on surveille les interactions (anticoagulants/antiagrégants, chirurgie), et on vise d’abord la correction alimentaire (poissons gras, noix, graines) quand c’est possible. La vitamine D, chez les patients Hashimoto, mérite une approche rationnelle : dosage de 25(OH)D, supplémentation si insuffisance, et suivi. Des méta-analyses suggèrent que la supplémentation peut réduire certains marqueurs d’auto-immunité et améliorer certains paramètres thyroïdiens dans des sous-groupes, mais tout n’est pas uniforme selon les protocoles (19). Le message pratique est simple : corriger une carence est pertinent, “sur-doser” sans suivi ne l’est pas.
Le sélénium est plus subtil. Il est biologiquement impliqué dans la thyroïde (sélénoprotéines, antioxydants), et des essais ont montré des effets sur les anticorps dans certains contextes, mais les résultats cliniques “ressentis” sont plus variables. Un essai randomisé récent, de grande valeur, a montré que sélénium et placebo étaient “également efficaces” sur l’amélioration de la qualité de vie dans une thyroïdite auto-immune, ce qui invite à éviter le réflexe systématique (20). En pratique, on réserve plutôt le sélénium aux situations où une insuffisance est probable, ou à des contextes ciblés, en restant prudent sur la dose et la durée (risque de sélénose à long terme si excès). Le duo myo-inositol + sélénium est parfois discuté dans l’hypothyroïdie infraclinique auto-immune, avec des études suggérant une amélioration du TSH et certains paramètres immunitaires (28). C’est une piste, surtout si l’on veut une stratégie de soutien métabolique et de sensibilité à l’insuline, mais ce n’est pas une alternative à la substitution quand elle est nécessaire, et cela demande une sélection de patients et un suivi biologique. Enfin, deux compléments “classiques” restent incontournables… quand ils sont indiqués : le fer (si ferritine basse et tableau clinique compatible) et la vitamine B12 (si déficit ou malabsorption). Leur intérêt est trivial mais immense : une carence martiale ou une carence en B12 peuvent mimer ou aggraver une hypothyroïdie, majorer la fatigue, accentuer la dyspnée, brouiller la cognition. La seule “complexité” est logistique : espacer ces prises de la lévothyroxine, car calcium et fer diminuent l’absorption de T4 (3).
À l’inverse, certains compléments “anti-stress” doivent être maniés avec prudence en contexte thyroïdien, notamment l’ashwagandha. Les fiches officielles de l’Office of Dietary Supplements (NIH) rapportent des cas de thyrotoxicose associés à l’ashwagandha, avec une possible interaction avec les traitements thyroïdiens (29). Des cas cliniques, anciens et récents, décrivent également thyrotoxicose ou thyroïdite indolore sous ashwagandha (30–32). Cela ne signifie pas que l’ashwagandha est “interdite”, mais que, chez un patient Hashimoto sous hormone thyroïdienne, palpitant et insomniaque, ce n’est pas un choix anodin. Une médecine nutritionnelle moderne ne juge pas les plantes “par réputation” : elle les juge par bénéfice/risque, contexte, dose et surveillance.
Un protocole qui s’adresse aux vraies causes
Il reste maintenant à traduire cette compréhension en protocole. Un protocole utile n’est pas celui qui promet “zéro fatigue”, mais celui qui restaure des rythmes, réduit les stress internes, et redonne de la marge au système. Il doit aussi être réaliste : si la personne est déjà en surcharge, on ne lui prescrit pas une vie plus compliquée. On prescrit des gestes simples, très répétables, qui envoient au cerveau un message cohérent : “la situation est stable, tu peux relâcher”. Avant de démarrer, trois règles de sécurité : premièrement, exclure une insuffisance surrénalienne vraie quand la clinique la suggère (hypotension, hyponatrémie, malaises, perte de poids, hyperpigmentation, hypoglycémies, antécédents auto-immuns multiples) et, si besoin, réaliser un cortisol matinal + ACTH puis un test de stimulation selon recommandations (4). Deuxièmement, sécuriser la substitution thyroïdienne (prise, interactions, observance) et s’assurer qu’on ne traite pas un problème d’absorption par une escalade de dose (1–3). Troisièmement, faire le bilan “carences + inflammation + métabolisme” de base, parce qu’il guide 80% des améliorations.
Ensuite, on peut proposer une stratégie de 4 semaines structurée, sans lourdeur, centrée sur 6 piliers. L’idée n’est pas de tout faire “parfaitement” dès le premier jour, mais d’empiler des victoires physiologiques.
- Ancrage circadien quotidien, 7/7. Heure de lever fixe (±30 min), même le week-end. Dans l’heure qui suit le réveil : 10 à 20 minutes dehors, lumière naturelle sur les yeux (sans regarder le soleil), idéalement en marchant doucement. Si climat/horaires impossibles, envisager une lampe de luminothérapie le matin (usage médical encadré). Le soir : baisse volontaire de la lumière 90 minutes avant le coucher, écrans atténués, et si possible pièce plus chaude le jour / plus fraîche la nuit. L’objectif n’est pas “dormir plus tôt” par volonté, mais de laisser la biologie avancer d’elle-même grâce aux signaux.
- Une fenêtre de sommeil protégée. On fixe une plage réaliste (par exemple 23h–7h) et on la protège comme un traitement. Si insomnie chronique (>3 mois), la TCC est prioritaire (12). Dans la semaine, on ajoute un rituel bref et répétable : douche tiède, lecture papier, respiration lente 5 minutes, étirements doux. Les patients “hyperactifs” aiment les routines compliquées ; on choisit l’inverse : une routine minimaliste, mais quotidienne.
- Stabilité glycémique dès le matin. Petit-déjeuner (ou premier repas) riche en protéines (20–30 g selon gabarit), avec fibres et graisses de qualité, et pauvre en sucre rapide. On réduit drastiquement les petits-déjeuners “céréales/jus/pain confiture” chez les profils anxieux, et on observe les effets sur la matinée et le soir. Si réveils nocturnes vers 2–4h, on suspecte souvent une fragilité glycémique et/ou un dîner inadéquat : on ajuste d’abord le repas du soir (protéines + fibres + glucides complexes selon tolérance), et on évite l’alcool sur 2 semaines pour tester l’impact sur le sommeil.
- Chrononutrition simple. Sur 2 semaines, on avance le dernier repas de 60 à 120 minutes (sans réduire les calories si la personne est déjà fragile), et on limite le grignotage tardif. Chez certains patients, une approche type “time-restricted feeding” tôt dans la journée peut être testée progressivement, surtout si syndrome métabolique, mais sans rigidité ni culpabilité (17). Le but est de réduire les signaux métaboliques nocturnes.
- Anti-inflammatoire pragmatique. Pendant 14 jours : diminution franche des aliments ultra-transformés, sucres liquides, alcool, fritures répétées. Augmentation des légumes, légumineuses si tolérées, fruits entiers, huile d’olive, poissons gras, herbes/épices, oléagineux. On vise un modèle méditerranéen “réaliste”, pas un régime identitaire (18). En contexte Hashimoto, toute éviction (gluten, lait, etc.) n’a de sens que si elle est individualisée (symptômes digestifs, coeliaque, intolérances avérées) et réévaluée.
- Mouvement dosé, pas héroïque. Chez le patient en “crash”, l’excès d’exercice est une agression. On commence par 20–40 minutes de marche quotidienne, idéalement à la lumière du jour. On ajoute ensuite 2 séances hebdomadaires de renforcement doux (20–30 min). L’objectif est d’améliorer la sensibilité à l’insuline, la masse musculaire, la variabilité autonome, sans déclencher de sur-stress.
Sur ce socle, les compléments (optionnels) se prescrivent comme des “béquilles” ciblées, pour 4 à 8 semaines, avec critères d’arrêt :
– Magnésium (bisglycinate ou citrate selon transit), plutôt le soir : si tension nerveuse, crampes, sommeil léger, ou alimentation pauvre en sources de magnésium. Ajuster à la tolérance digestive. Références d’intérêt sur le sommeil (21).
– Glycine 3 g 30–60 min avant coucher : si sommeil non réparateur, ruminations, sensation de “cerveau chaud”. Données cliniques et mécanistiques (22,23).
– L-théanine 100–200 mg le soir : si hyperéveil cognitif, anxiété légère à modérée, en complément d’une hygiène de sommeil solide (24).
– Oméga-3 (dose à individualiser) : si faible consommation de poissons gras, inflammation, symptômes anxieux, avec surveillance des interactions (25–27).
– Vitamine D : seulement si insuffisance documentée, avec objectif et suivi biologique (19).
– Fer (si ferritine basse/clinique compatible) et B12 (si déficit) : correction prioritaire, en respectant l’espacement avec la lévothyroxine (3).
– Sélénium : pas systématique en Hashimoto ; discussion au cas par cas, prudence dose/durée, et intégration des données cliniques récentes (20).
– Myo-inositol + sélénium : option dans certains profils d’hypothyroïdie infraclinique auto-immune, toujours avec suivi TSH/FT4 et discussion bénéfice/risque (28).
– Ashwagandha : à éviter ou à manier avec une grande prudence chez les patients sous hormones thyroïdiennes, avec antécédents de palpitations, ou terrain de thyrotoxicose ; données de sécurité officielles et cas publiés (29–32).
Le suivi pratique peut se faire avec trois indicateurs simples, plus utiles que mille tests : énergie au réveil (0–10), somnolence diurne (0–10), et qualité de sommeil (0–10) + un symptôme “cardinal” choisi par le patient (brain fog, anxiété, transit, douleurs). On note 2 fois par semaine. Si, à 2 semaines, l’énergie du matin et l’endormissement se sont améliorés, on sait que l’axe du stress et le rythme circadien reprennent de la cohérence. Si rien ne bouge, on remonte l’enquête : apnées du sommeil ? dépression/anxiété majeure ? surdosage thyroïdien ? déficit martial ? inflammation active ? travail de nuit non compensé ? médicament stimulant ?
Dr. A. D’Oro
Références
- Jonklaas J, et al. Guidelines for the Treatment of Hypothyroidism: Prepared by the American Thyroid Association Task Force on Thyroid Hormone Replacement. Thyroid. 2014.
- Centanni M, et al. ETA guidelines for the use of levothyroxine sodium preparations in monotherapy to optimize the treatment of hypothyroidism. Eur Thyroid J. 2025.
- Wiesner A, et al. Levothyroxine Interactions with Food and Dietary Supplements. (Revue, PMC). 2021.
- Bornstein SR, et al. Diagnosis and Treatment of Primary Adrenal Insufficiency: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2016.
- Wilber JF, Utiger RD. The effect of glucocorticoids on thyrotropin secretion. J Clin Invest. 1969.
- Iranmanesh A, et al. Dynamics of 24-hour endogenous cortisol secretion and clearance in primary hypothyroidism assessed before and after partial thyroid hormone replacement. J Clin Endocrinol Metab. 1990.
- Cadegiani FA, Kater CE. Adrenal fatigue does not exist: a systematic review. BMC Endocr Disord. 2016.
- Endocrine Society. Adrenal Fatigue (ressource patient). 2022.
- Adam EK, et al. Diurnal cortisol slopes and mental and physical health outcomes: A systematic review and meta-analysis. Psychoneuroendocrinology. 2017.
- Akturk HK, et al. Over-the-Counter “Adrenal Support” Supplements Contain Thyroid and Steroid-Based Adrenal Hormones. Mayo Clin Proc. 2018.
- Spiegel K, et al. Impact of sleep debt on metabolic and endocrine function. Lancet. 1999.
- Riemann D, et al. Insomnia Guidelines—The European Update 2023 (synthèse des recommandations ESRS). 2023.
- Jeong H, et al. The relationship between shift work pattern and thyroid… (article PMC). 2023.
- Kwon S, et al. Association between shift work and the incidence/risk of hypothyroidism (cohorte). 2023.
- Sutton EF, et al. Early Time-Restricted Feeding Improves Insulin Sensitivity, Blood Pressure, and Oxidative Stress (essai contrôlé). Cell Metab. 2018
- Koelman L, et al. Mediterranean diet and inflammatory biomarkers: systematic review/meta-analysis of randomized trials. 2022.
- Tang J, et al. Vitamin D supplementation and autoimmune thyroiditis/Hashimoto: meta-analysis (impact sur auto-anticorps et/ou fonction). 2023–2025.
- Larsen CB, et al. Selenium supplementation vs placebo in autoimmune thyroiditis: résultats sur qualité de vie (essai randomisé). 2024.
- Mah J, Pitre T. Magnesium supplementation and insomnia: systematic review/meta-analysis. 2021.
- Yamadera W, et al. Glycine ingestion improves subjective sleep quality (étude clinique). 2007.
- Bannai M, et al. Glycine and sleep: données mécanistiques/physiologiques. 2012.
- Bulman E, et al. L-theanine and sleep/stress: systematic review/meta-analysis. 2025.
- Su KP, et al. Omega-3 Fatty Acids & Anxiety Symptom Severity: systematic review/meta-analysis. JAMA Netw Open. 2018.
- JAMA Network Open. Reanalysis After Retraction of Included Article (omega-3 et anxiété). 2023.
- Bafkar N, et al. Omega-3 Fatty Acids for Anxiety Symptoms: Meta-analysis. 2024.
- Nordio M, Basciani S. Myo-inositol plus selenium supplementation restores euthyroid state in Hashimoto’s patients with subclinical hypothyroidism. 2017.
- NIH Office of Dietary Supplements. Ashwagandha—Fact Sheet for Health Professionals (sécurité, interactions, cas de thyrotoxicose). 2025.
- van der Hooft CS, et al. Thyrotoxicosis following the use of ashwagandha (cas clinique). 2005.
- Kamal HI, et al. Ashwagandha as a Unique Cause of Thyrotoxicosis (cas, revue). 2022.
- Hayashi M, et al. Painless thyroiditis by Withania somnifera (Ashwagandha). 2024.
© 2026, Dr. A. D’Oro. All rights reserved.